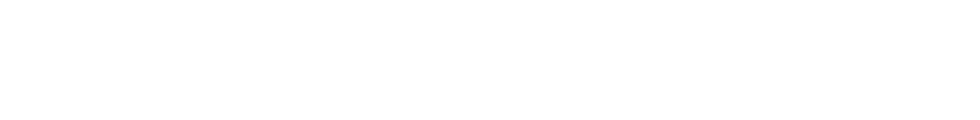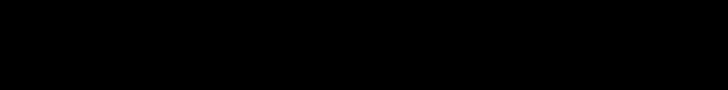Originaire de Sud de la France, Samira Sedira a suivi l’École de la Comédie de Saint-Étienne, à la fin des années 80. Elle a ensuite joué sur la plupart des centres dramatiques nationaux sous la direction de prestigieux metteurs en scène avant de se retrouver dans l’obligation de faire des ménages, comme sa mère jadis, pour assurer sa survie financière. Elle se raconte dans «l’Odeur des planches» aux éditions du Rouergue. Rencontre avec une femme étonnante et sincère :
Comment vous est venue cette passion pour le théâtre ?
Par hasard… Je n’ai jamais eu la vocation du théâtre. Enfant, je n’y avais jamais rêvé. Cela est arrivé tardivement, alors que j’étudiais à la faculté d’Aix-en-Provence. Par une après-midi d’errance (je me baladais souvent au lieu d’aller en cours), je me suis laissée tenter par une affiche collée à l’entrée du resto U qui annonçait le démarrage prochain de la nouvelle saison du théâtre universitaire. Ils cherchaient de nouveaux membres. Je me souviens m’être dit : « tiens, ça a l’air amusant, et pas trop fatigant ». Je m’y suis rendue, j’ai aimé ça tout de suite. Je ne savais pas encore que j’avais pris perpète.
La culture était-elle présente chez vous, plus jeune ?
Tout dépend ce que l’on entend par « culture ». Nous n’avions pas de livres, nous n’allions pas au spectacle, le mot « théâtre » n’avait aucun sens pour nous, pas plus que l’opéra, mais nous aimions Dalida, Delpech, Claude François et les autres… Nous aimions rire des pitreries de Louis de Funès, quand il passait à la télé, Fernandel, Bourvil… Tout ce qui compose la culture populaire. Plus tard, je me suis intéressée aux auteurs exigeants, à la musique, à la littérature… Je suis constituée de tout ça à la fois.
Pourquoi l’école de la Comédie de Saint-Étienne ?
Encore le hasard… Mon compagnon de l’époque en avait entendu parler et m’a proposé de passer le concours. Je me suis sagement exécutée, et je ne le regrette pas. Je l’en remercie d’ailleurs.
En tant qu’étudiante, comment trouviez-vous la ville de Saint-Étienne ?
Saint-Étienne est ma ville de cœur. J’y ai passé quelques années (entre 1988 et 1993). J’ai aimé y vivre, aimé m’y « inoculer » le virus du théâtre, aimé les odeurs du dimanche matin, sur le marché place Boivin, l’hospitalité des Stéphanois, cette façon si particulière qu’ils ont de vous accueillir, et puis bien sûr la présence invisible (mais si palpable) de Jean Dasté, un des plus grands hommes de théâtre de l’histoire de ce pays.
Vous avez beaucoup joué sous la direction de R. Brunel. Quel regard portez-vous sur son parcours ?
Richard a un parcours exceptionnel, fulgurant. Mais il ne le doit qu’à son travail (c’est une bête de somme !) et à l’amour profond, sans faille, qu’il voue au théâtre.
Vous avez beaucoup joué puis, plus rien. Comment l’expliquez-vous ?
Lorsqu’une histoire s’arrête, on a toujours du mal à en comprendre les raisons. C’est toujours très mystérieux. Je ne sais pas… tout est imbriqué, les raisons sont diverses et mêlées, un vrai sac de nœud. Chaque acte ou non-acte suscite une réaction ou au contraire une absence de réaction : les rôles ne se présentent plus, cela a pour effet de m’éloigner peu à peu des théâtres, on ne me voit plus, on ne pense plus à moi, moi de mon côté, je ne fais rien pour me rendre un peu plus visible, je ne provoque rien… et voilà comment on est oublié, et aussi comment l’on se fait oublier… un enchaînement de malentendus…
Vous décrivez un milieu du théâtre assez ingrat et autocentré. Votre réalité ?
Disons qu’au théâtre, tout se passe bien tant que vous travaillez régulièrement et que vous renvoyez une image positive de vous-même. Quand les choses s’arrêtent pour vous, curieusement il n’y a plus personne.
Pensez-vous que vos origines sociales et/ou ethniques ont eu un impact sur votre carrière au théâtre ?
Très franchement, non. On ne me l’a jamais fait sentir et d’ailleurs j’ai joué toutes sortes de rôles sans aucune discrimination. C’est au cinéma que les choses sont plus compliquées : un arabe reste un arabe. Ils sont voyous, balayeurs, ouvriers, mais rarement avocats ou pompier ou médecins Le cinéma qui se targue d’être le reflet de la société est complètement à côté de la plaque : les hôpitaux sont remplis de médecins d’origine maghrébine !
Vous dites en vouloir à vos « taiseux lamentables », vos pères, pour ne pas avoir eu le courage de s’imposer… Une forme de soumission à la base de la révolte de la seconde ou troisième génération… ?
Je pense effectivement que si « nos pères » avaient su s’imposer avec plus de fermeté, les enfants n’auraient pas eu besoin de le faire avec autant d’acharnement. D’une certaine manière, ils subissent encore les dégâts engendrés par le silence des anciens. Nos parents sont toujours restés à la périphérie de la société française… et pourtant ils ont pleinement participé à l’élaboration de cette dernière ! Les enfants eux désirent bien plus que ça, ils sont nés sur le sol Français, parlent français, respirent français, mangent français… on peut donc comprendre que l’exclusion ressentie (géographique et culturelle) peut parfois faire péter les plombs à certains. Quand on ne vous entend pas, on hurle. Quand on ne vous voit pas, on s’agite. Et puis quand il n’y a plus rien à faire, on fait des feux gigantesques… c’est comme lancer des fusées de détresse en pleine mer.
Vous décrivez fort bien la frustration et la soumission, consciente ou inconsciente dans laquelle sont enfermés, de fait, les immigrants. Une notion pourtant étrangère à celui qui n’a pas connu l’exil… ?
L’exil n’est pas seulement géographique. Un chômeur est un exilé, un détenu est un exilé, un dépressif est un exilé. Pour moi, exilé veut dire « étranger à » de fait on peut être étranger au monde, à soi-même, à son âme… Tout le monde a déjà connu l’exil…
Les gens du théâtre n’ont-ils pas trahi quelque part Jean Dasté en se satisfaisant de leur propre statut ?
Je ne sais pas… peut-être que dans les moments où l’on sent que l’on s’égare on devrait revenir au travail de Jean Dasté, à sa pensée, à l’extraordinaire projet de rendre au peuple son histoire. Car il ne faut pas oublier que les auteurs se nourrissent de ça : des histoires des gens, c’est eux qu’ils racontent. Alors peut-être que les metteurs en scène devraient se le rappeler de temps à autre… oui… de temps à autre…
Écrire ce livre était-ce le moyen de retrouver une conscience créatrice ?
Disons qu’écrire me permettait de ne pas rompre le fil de la création.
À quel moment de votre histoire avez-vous pensé à utiliser les mots de l’écriture ?
Dès le début. Comme pour contrebalancer la cruauté de la situation, me rehausser, l’écriture m’a tenue debout, m’a maintenue en vie.
Écrire vous a-t-il permis d’évacuer cette rage ?
Le mot rage me semble inapproprié. Je parlerais plutôt de colère (bien légitime). Je n’ai pas cherché à l’évacuer, mais à la « transformer ». Une sorte de résilience artistique.
Était-ce une forme de thérapie ?
Non. Très franchement, si l’art guérissait ça se saurait. L’écriture est en moi depuis toujours. J’ai toujours écrit, mais je n’étais jamais allé au bout d’un projet. Si je pousse un peu plus loin ma réflexion, je dirai même que mon histoire est presque un prétexte à l’écriture. C’est d’abord l’écriture, ensuite mon histoire.
De cet aller-retour permanent entre la vie de votre mère et la vôtre résulte un constat plutôt pessimiste, pourtant votre parcours était plutôt brillant ?
Il faut comprendre qu’au moment où j’ai écrit ce texte, je n’avais aucune raison d’être fière de moi. Ce sont des mots taillés dans la chair du présent. Avec du recul, de la distance, je pense effectivement que mon parcours est un assez beau parcours.
Pourquoi ne pas avoir utilisé la scène et le théâtre pour vous livrer ?
Tout d’abord, comme je le dis plus haut, ma passion pour l’écriture a toujours coexisté avec ma passion pour le théâtre. Ensuite, je trouve que la forme très intimiste que j’ai choisi de développer, très à fleur d’intériorité, s’accommode peu d’une version scénique. Je n’avais pas réellement envie de « dire », juste une envie de chuchoter…
Pour toutes les femmes de ménage qui vont vous lire, certains de vos propos peuvent-ils paraître dénigrants ?
C’est à vous de me le dire. Pour ma part, je ne vois rien de dénigrant dans ce que j’ai écrit. C’est au contraire un hommage que je leur rends. Personne n’a la vocation du ménage. Aucun enfant ne rêve de devenir femme, ou homme de ménage. On le fait parce qu’on y est obligé, et qu’il n’y a aucune autre issue. Ce sont des métiers extrêmement difficiles, peu gratifiants, peu valorisants… Il y a l’usure du corps, l’épuisement, le tarissement de la réflexion, toutes ces tâches répétitives, qui à force, n’ont plus de sens, c’est une véritable dépossession de soi… Je suis désolée mais je ne vois rien là de bien engageant. J’ai une grande admiration et un profond respect pour ces hommes et ces femmes qui n’ont d’autre horizon que celui-là. Je ne comprends pas où ils trouvent la force de continuer.
Vous n’avez pas choisi d’écrire sous un pseudo, était-ce une façon d’affirmer que si le théâtre ne voulait plus de vous, vous pouviez quand même occuper le devant de la scène ?
Non, c’est tout simplement une autre façon de créer. Quand on a demandé à Samuel Beckett pourquoi il écrivait, il a répondu : « Bon qu’à ça ». Il a tout dit.
Vous dites que ceux qui auraient pu vous aider ne l’ont pas fait, mais aviez-vous demandé cette aide ?
Alors là, on touche à une problématique propre aux acteurs. Le comédien vit continuellement dans l’attente du désir de l’autre, l’autre étant le metteur en scène. Il est toujours délicat d’aller provoquer le désir d’autrui, toujours compliqué d’aller « vendre » sa propre peau. L’instrument de l’acteur, c’est lui-même. Rien entre lui et la personne susceptible de l’engager. C’est un artiste sans protection, ce qui le rend plus vulnérable que les autres. Un musicien a son instrument, un peintre sa toile, un danseur la musique : l’acteur est seul avec lui-même. Alors pour répondre à votre question, j’ai tendu quelques perches, timidement, sans convictions… et disons que personne n’a eu l’ouïe assez fine…
Après cette publication, avez-vous envoyé votre livre aux directeurs de théâtre et chefs de troupe ?
À quelques-uns, oui.
Quels retours avez-vous eu ?
Eh bien quelques lectures sont prévues. Mais rien n’est fait. Je préfère donc ne pas en dire trop.
Vous dites que vous n’êtes plus chez vous au théâtre, est-ce définitif ?
Je ne dis pas que je ne suis plus chez moi, je dis très exactement : « Je suis chez moi, et bien sûr je ne suis plus chez moi ». C’est différent puisque j’inclus la notion d’ambiguïté, une ambivalence parfois douloureuse. Rien n’est jamais définitif. Pour l’instant une partie de moi est en exil. Et comme tout exilé, je rêve parfois d’un retour au pays…
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Oui. J’espère ne jamais m’arrêter !
Qu’attendez-vous de ce livre ?
Qu’il soit lu. Qu’il vive longtemps dans le regard et dans le cœur des gens. Un peu comme au théâtre…