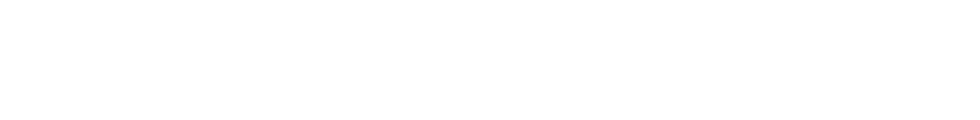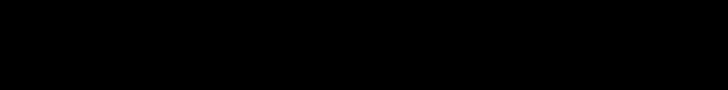Après avoir dirigé le Centre Dramatique National de Sartrouville neuf années durant, Laurent Fréchuret est revenu à ses premiers amours, la mise en scène, Saint-Étienne et Beckett. Rencontre avec un artiste passionné :
À quand remonte ton retour à Saint-Étienne avec le Théâtre de l’Incendie, la compagnie que tu as créé ici dans les années 90 ?
Cela fait deux ans.
As-tu retrouvé tes marques ?
Avec le Théâtre de l’Incendie, qui a donc été réveillé il y a deux ans après mon passage à Sartrouville, nous avons fait de Saint-Étienne notre base naturelle. Revenir ici avait beaucoup de sens pour moi, renouer avec mes racines tout en tissant de nouveaux liens. Lorsqu’on revient quelque part 10 ans après en être parti, on a toujours des surprises. En 10 ans, beaucoup de choses ont changé, notamment dans le milieu théâtral ou des institutions culturelles… Ce qui dure trop longtemps s’épuise toujours. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu relancer cette compagnie, après 9 années de direction d’un CDN. Je voulais redevenir une sorte d’électron libre.
Tu avais annoncé ta volonté de quitter la direction après 3 mandats successifs. Tu as exactement fait ce que tu as dit, ce qui est rare dans ce métier…
Je dirigeais tous les jours 50 personnes…C’était très lourd.
Rares sont ceux qui ont goûté à une certaine forme de confort et qui ont le courage de s’en séparer pour renouer avec cette liberté…
Chaque cas est particulier aussi et c’est pour cela que je ne peux que parler de mon cas. Et pas de celui des autres. Pour moi, retrouver le Théâtre de l’Incendie, c’était une forme de survie, indispensable. De ressource. La vie est courte et elle se doit d’être riche d’expériences et d’aventures différentes. C’est bien, je crois, de prendre des risques. J’avais croisé Jean Dasté à l’époque j’avais 18 ans. Il en avait 90 ans. Il m’a offert un livre, « Le théâtre et le risque ». Le théâtre est indissociable du risque. Le théâtre se doit d’être, à chaque fois, une prise de risque. Si l’on reste trop dans le confort, on oublie que le risque est un des carburants essentiels à la création.
Gérer un CDN, au-delà de la masse considérable de travail, apporte un confort, ne serait-ce que financier…
Il y a certes un confort mais aussi toutes les angoisses qui vont avec. Et elles peuvent être terribles. Les angoisses sont quotidiennes lorsque tu dois gérer une boutique de 50 personnes. De plus, en tant que directeur et artiste, tu dois affronter deux métiers en même temps. Si on veut bien faire le boulot, on doit faire deux plein-temps. Après tu peux t’évader en faisant des mises en scène partout ailleurs, ou tu peux t’enfermer dans ton bureau à gérer tous les problèmes administratifs en oubliant de faire de l’artistique. À chaque instant, tu dois te demander si tu es en capacité d’occuper deux plein-temps. Quand tu peux le faire, c’est simplement formidable. Et quand tu ne peux plus le faire, il faut l’accepter aussi.
Tu n’étais plus en mesure de faire ces deux plein-temps ?
Je me disais que si je restais trois ans de plus, je n’aurais pas été en mesure de faire les deux, effectivement. Mon autre volonté forte était de relancer la compagnie sur des bases stéphanoises.
Comment s’est déroulé le retour à Saint-Étienne ?
La transition a été plus agréable car nous avons très rapidement eu de beaux projets comme « Richard III », « Sainte dans l’Incendie », « À portée de crachat », ces deux dernières pièces ont beaucoup tourné et continuent de tourner d’ailleurs. « Sainte dans l’Incendie » sera programmée à la rentrée à la Comédie de Saint-Étienne. Sur ces 6 dernières années, on l’aura joué 200 fois. C’est extraordinaire !
Ce n’est pas ton « En attendant Godot » qui est programmé à la Comédie mais bien ce spectacle autour de la figure de Jeanne d’Arc…
Je crois savoir qu’Arnaud Meunier avait un engagement préalable avec un autre Godot, il faut savoir que 2015 aura été l’année de tous les Godot… Il y avait l’année des méduses, et il y aura l’année des Godot, cela pourrait faire peur d’ailleurs. J’ai décidé de voir tous les Godot qui ont été montés et je les ai pratiquement tous vus avec un énorme plaisir. À chaque fois, c’était comme des séances de travail. Chaque mise en scène révélant une nouvelle lecture de cette œuvre inépuisable.
Il faut savoir que tu es presque né, théâtralement parlant, au début des années 90 avec Samuel Beckett…
Au théâtre, Beckett m’accompagne depuis mes débuts. C’est en lisant les romans de S. Beckett, et tout particulièrement la trilogie romancée, « Molloy », « L’innommable » et « Malone » en 1990 (j’avais alors 25 ans) que j’ai compris que cette voix, qui est la même à travers toute l’œuvre de l’auteur, romans, poèmes, pièces radiophoniques avait quelque chose d’unique qui me touchait profondément. J’ai lu les 30 volumes de Beckett quand j’avais 25 ans, en deux ou trois années seulement, j’ai compris que cette œuvre représentait un matériau extraordinaire. À l’époque, j’ai réussi à convaincre Jérôme Lyndon, le légataire judiciaire de son œuvre, de me céder des droits qu’il n’avait jamais donné avant. Il a accepté de me donner les droits d’adapter cette trilogie romancée au théâtre, ce qu’il n’avait jamais accepté avant pendant 50 ans. C’est le début de notre compagnie, de notre aventure explorant alors la région Rhône-Alpes avec nos créations. Le Théâtre de l’Incendie s’est fait reconnaître grâce à ce travail sur Beckett, puis nous avons cheminé avec lui en montant, il y a dix ans, « Oh, les beaux jours », puis nous avons édité avec les Editions de Minuit de Jérôme Lyndon un livre intitulé « Tous ceux qui tombent », avec l’enregistrement de cette même pièce qui n’avait plus été enregistrée depuis 60 ans, depuis Roger Blin. Enfin, arrivant à un âge dit de maturité, je pense plutôt à G. Brassens qui à cet âge (à mon âge) disait, « je ne suis plus un jeune con mais pas encore un vieux con », quelque part entre les 2 âges, je me suis dit qu’il fallait relire la pièce que je n’avais jamais voulu monter avant « En attendant Godot ». Le chef-d’œuvre absolu de Beckett. Qu’ai-je découvert en le relisant ? Une chose extraordinaire, j’ai toujours pensé qu’il s’agissait d’une pièce dans laquelle il ne se passait pas grand-chose…Or, je me rends compte que quel que soit le Godot qu’on attend, Godot pour certains c’est Dieu, pour d’autres c’est rien, pour d’autres encore c’est un sandwich parce qu’ils ont trop faim ou un boulot synonyme de survie. Pour d’autres encore ce sera l’amour parce qu’ils sont trop seuls… Notre ambition sera de faire en sorte que chaque spectateur dans la salle rencontre son Godot, sans lui imposer quoi que ce soit. Il n’y a pas de Godot unique, si Beckett a appelé sa pièce Godot sans jamais expliquer le pourquoi du comment de Godot, c’est bien parce que nous ne savons pas, nous ne savons pas et parce que nous ne savons pas, alors vivons heureux en attendant la mort. Que dit Beckett, « inventons ensemble des choses en attendant Godot ». C’est tout le contraire d’une pièce apocalyptique ou sur la fin du monde, déprimante, ou triste, ou vide. Cette pièce est remplie d’actions, elle est remplie de jeux de langage et de mots. N’oublions pas que Beckett ne parlait pas français à l’âge de 20 ans et qu’il deviendra celui qui va dynamiter cette langue française. Il deviendra l’un des plus grands auteurs français. C’est celui qui va renouveler la langue française en la triturant dans tous les sens, en découvrant de nouvelles choses…
Peut-être parce qu’il n’était pas français justement…
Sans aucun doute, oui.
Et cette lecture de Godot, tu ne l’avais pas saisi à 25 ans ?
Non, je l’ai eu maintenant. C’est grâce à la vie, à l’expérience et à tout le travail qu’on a mené ces années. Beckett a dit plusieurs choses dans ses poèmes qui sont comme des haïkus. Il a dit « Vivre et inventer, j’ai essayé ». Vladimir et Estragon, les deux personnages de la pièce, à leur façon, inventent et vivent dans l’adversité. La tragédie, elle existe, mais dans la tragédie, un peu à la façon de Shakespeare, Beckett y mêle un peu de burlesque et de comédie. Buster et Chaplin, ne l’oublions pas, étaient les maîtres de Beckett. En 1948, Beckett, au milieu des souffrances que lui impose l’écriture de ses romans, « Molloy », « L’innommable » et « Malone », décide de s’accorder une sorte de pause récréative, en écrivant, dit-il, une « petite pièce »…, avec des petits personnages qui attendent quelqu’un, des petites répliques rigolotes… Et cette pièce montée, 4 ans plus tard par Roger Blin, dans un petit théâtre de la Rive Gauche à Paris, va devenir l’une des pièces les plus importantes du 20ième siècle. Parce qu’elle renouvelle et interroge le théâtre. Beckett, ne venant pas du théâtre, s’octroie une liberté totale. Comme il a fait avec la langue française. Il remet tout en cause. En langue française qu’il vient tout juste d’apprendre, Beckett fera faire un bond de 50 ans au théâtre.
C’est un peu comme ces grands chefs qui ne sont pas français mais qui osent des choses que nos propres grands chefs n’auraient jamais osé faire…
La comparaison avec la cuisine n’est pas fausse, en effet. C’est vrai que Beckett aura la liberté du naïf, de l’inconscient ou du premier venu. En 1948, Beckett ose réinventer la langue française, mais à cette époque, on oublie un peu vite qu’il sort aussi de 5 années de Résistance. Beckett n’est pas un homme qui vit enfermé dans une bulle, non, il vient de fuir la Gestapo, parce qu’il fait du trafic de microfilms, Beckett entre dans la Résistance dès les premiers jours du conflit, et en tant qu’Irlandais, il aurait très bien pu rentrer tranquillement chez lui. Non, il choisit de rester en France et de résister pleinement. Au départ, il reste pour sauver des amis juifs en passe d’être arrêtés, il fuit ensuite dans la France Libre, à Roussillon parce qu’il est recherché par la Gestapo. Il s’enfuit avec sa femme. Lorsqu’on lui parle de Vladimir et d’Estragon comme deux êtres qui sans cesse se chamaillent tout en restant ensemble, Beckett répond, « Vladimir et Estragon », c’est « ma femme, Suzanne, et moi ». C’est une histoire de vieux couple. Après 1948, Beckett aide également à reconstruire la France en aidant à reconstruire le village de Saint-Lô en Normandie. Il est dans le concret, Beckett. Il fait acte de résistance. Il est pleinement engagé dans son temps. Contrairement à ce que l’on dit souvent à son sujet, il n’est pas autiste, il est totalement politique et dans la langue française, il est totalement poétique. C’est exemplaire d’avoir un génie aussi créatif aussi impliqué dans son époque et son temps.
Tes deux autres pièces sont d’actualité également, « À portée de crachat », autour du conflit Palestinien, et « Sainte dans l’Incendie » sur la foi…
Je ne suis pas sûr que Jeanne d’Arc soit d’actualité…
Il est question de foi et ne constate-t-on pas un regain d’intérêt sur la foi, dans toute sa complexité ?
Ma Jeanne d’Arc n’est pas complètement d’actualité parce qu’elle est, dans la pièce, une sorte d’artiste d’art brut qui réinvente sa propre religion.
N’est-ce pas le cas aujourd’hui ?
Ma Jeanne d’Arc réinvente sa religion en regardant une vache, un chardon, ses amis… Je suis un peu Bouddhiste dans l’âme. J’ai tendance à penser que Dieu, s’il est, est un peu partout. Après, dans notre profonde solitude, nous avons tous besoin de choses qui puissent nous relier. Face à la marchandisation effrénée de notre époque, nous avons sans doute besoin d’un ailleurs.
Le marché n’est pas tout ?
Sans doute sommes-nous arrivés au bout d’une aventure. Au bout de la catastrophe capitaliste. Au bout d’un moment, c’est tellement désespérant que les souffrances deviennent insupportables. Nous avons besoin de quelque chose à partager ensemble, parfois c’est un dieu.
On constate en France, une renaissance de certains mouvements catholiques…
Dans ma pièce, Jeanne agit parfois seulement pour rentrer en contact avec l’autre. Pour nouer un lien, l’art est une relation. Une œuvre d’art, certaines personnes vont la regarder puis ils vont réagir. Pour nous autres, hommes de théâtre, l’œuvre d’art est peut-être cette rencontre singulière entre ce que nous faisons et le public qui assiste à cette représentation. « Jeanne d’Arc », pour moi, est une métaphore d’un chef de troupe, c’est un peu moi déguisé, puisque j’ai écrit 80% de ce texte avant de choisir cette figure de Jeanne d’Arc. Jeanne d’Arc n’est que le fil conducteur de la fable que j’ai imaginée qui évoque toutes mes obsessions depuis toutes ces années. Avec mes compagnons d’aventure, nous nous réunissons pour mener une aventure de troupe et inventer une histoire qu’on va raconter aux gens. Cette pièce me permet aussi d’évoquer ma passion pour le Moyen-Age. D’aucuns parlent de cette période comme une période sauvage, voire barbare. On parle toujours de l’obscurantisme du Moyen-Age. Or, je crois que le Moyen-Age est surtout une période solaire. Durant cette période, on constate une forme de naïveté que l’on retrouve d’ailleurs dans l’art brut. Puis, il y a cette obsession de l’incendie et du feu… L’incendie est ce qui crée tout en détruisant autre chose. C’est pour cela sans doute que je suis parti de Sartrouville, j’ai toujours besoin de détruire pour reconstruire autre chose. Comme s’il fallait que je démolisse quelque chose que j’ai passionnément construit. Mais au bout d’un moment, je dois démolir pour reconstruire quitte à prendre de gros risques. Et à se faire peur, c’est ça qui me plaît.
« Godot » sera créé pour l’estival de Bâtie ?
Nous créons cette pièce dans le cadre des Nuits de la Bâtie puis nous la jouerons courant juillet en Avignon au Théâtre des Halles, grâce à la confiance d’Alain Timar et de toute son équipe.
Un tel séjour à Avignon doit coûter cher pour une compagnie indépendante ?
Nous avons la chance de jouer dans un théâtre qui a une vraie éthique. Le Théâtre des Halles et Alain Timar choisit sa programmation et ne demande pas aux compagnies de payer pour jouer. C’est l’un des rares théâtres d’Avignon à agir ainsi. Ils font un vrai travail de théâtre. Ici, ce n’est pas la grande foire du marchand du temple. Ici, on parle théâtre. Nous sommes cependant très heureux de pouvoir jouer la pièce dans la région à la Bâtie. C’est aussi pour cela que nous sommes revenus ici, nous jouerons Beckett sous les étoiles, on attend Godot sous les étoiles, j’ai vraiment hâte d’y être ! J’espère toutefois qu’il ne pleuve pas trop…
Quel regard portes-tu sur ce qui s’est passé à l’Opéra de Saint-Étienne ?
J’ai un peu suivi cela, oui. Depuis plus de 20 ans, je travaille de manière régulière avec l’Opéra de Saint-Étienne. J’aime pouvoir travailler autour de ce théâtre musical. Qu’on appelle aussi lyrique… Nous avons fait « Barbe bleue » de Bartok, nous y avons joué « L’Opéra de Quat’sous » et plus récemment « Werther » de Massenet… Ce furent toutes de très belles aventures. Pour le reste, les polémiques ne me concernent pas, je veux passer mon temps à imaginer de nouvelles histoires et les partager avec le plus large public. Le reste, cela ne m’intéresse pas ou peu. Les polémiques appartiennent à d’autres, pas à moi.
Tu vas également jouer à la Comédie de Saint-Étienne la saison prochaine ?
Je tiens ici à souligner le travail que mène avec brio Arnaud Meunier et toute son équipe. Il y a beaucoup de gens à la Comédie que je connais depuis longtemps. J’aime beaucoup cette maison qui va se reconstruire vers le Zénith. Je suis très heureux d’y jouer à nouveau. Je les remercie encore.
Tes projets ?
Nous aurons l’année prochaine une très belle aventure au Théâtre du Rond-Point à Paris tenu par Jean-Michel Ribes qui m’invite à mettre en scène un texte de Blandine Costaz, une jeune auteure très prometteuse. Je mettrais en scène deux excellents comédiens Marianne Basler et Gilles Cohen, deux grands comédiens.
Une belle reconnaissance ?
C’est surtout un plaisir de jouer au Rond-Point, je fais partie du comité de lecture du Théâtre du Rond-Point. Nous lisons des textes pour défricher des auteurs d’aujourd’hui. C’est très motivant. C’est passionnant. Ce théâtre est une vraie ruche créative. La saison prochaine, nous jouerons également à Bruxelles, au Théâtre Le Public, la création d’une pièce que je veux monter depuis plus de 10 ans, « Les présidentes », de Werner Schwab, un auteur décédé dans les années 90, il avait 35 ans je crois, il a écrit une pièce totalement délirante et déjantée autour de trois femmes en état d’affabulation, trois femmes frustrées qui s’inventent des mondes par la parole… Mais leur histoire va finir par un fait divers sordide car elles tueront l’une d’entre elles. Nous sommes dans quelque chose qui pourrait être du domaine « Des bonnes » de J. Genet en version punk. J’aurai la chance de travailler avec trois comédiennes magnifiques, dont Laurence Vielle qui incarne « Ma Jeanne d’Arc » dans « La Sainte dans l’Incendie ». Nous jouerons et répéterons pendant trois mois à Bruxelles. 40 dates sont programmées… Tu vois, tout en restant stéphanois, nous nous baladons beaucoup. On se balade. Avec le théâtre, on est toujours dans le voyage dans l’espace et dans le temps.
Et revenir dans une autre institution ?
Pour le moment, je n’y pense pas trop. Peut-être que cela arrivera… Pour le moment, non. J’aime bien vivre au présent, et je me sens complètement investi dans le Théâtre de l’Incendie. À partir de Saint-Étienne, pour aller brûler à droite et à gauche.
Qu’est-ce qui t’intéresse tant dans cette ville, outre le fait d’y être né ?
J’y ai, en effet, toute mon enfance, ma jeunesse… C’est un réservoir. Très fort. Les amis. La famille. J’aime aussi voir comment cette ville change. De voir qu’il y reste beaucoup d’espaces et de temps pour rêver et travailler. Je suis persuadé que cette ville possède un potentiel toujours sous exploité. Pour moi, cette ville a changé… Des gens ont quitté la ville, des magasins ont fermé, tout n’est pas rose, non plus. Je pense même que le soir venu, elle est parfois endormie… Mais je trouve que cette ville est belle, non pas d’architecture ou de bâtiments, mais d’humanité et de relations. Des humanités et des relations à renouer et à réinventer. Il y aussi un peu de vide à repeupler. Et il y a toujours cette petite étincelle qui fait que la rencontre, à tout moment, peut se faire. Il y a ce lien qu’on ne trouve pas partout ailleurs. Ici, la relation peut-être belle, très belle.
Tout va bien, donc ?
Oui, je suis plutôt heureux en ce moment.