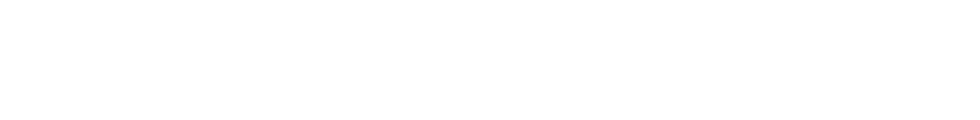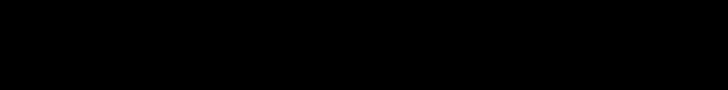Les révolutions dites Arabes, qui au final ne correspondent qu’aux événements de Tunisie et d’Égypte, nous auront au moins montré que les limites des soulèvements des peuples ne se situent pas tant dans l’affirmation d’une autorité militaire, policière ou arbitraire que dans une prise de conscience collective de la possibilité d’une alternative politique. C’est bien de leur esprit que les hommes sont prisonniers, la chute du mur de Berlin, et par la suite du Bloc de l’Est, l’avait d’ailleurs déjà montré. Mais lorsque l’esprit s’est libéré, il est un mal, tout aussi néfaste et puissant, qui guette le peuple, c’est celui de l’endettement, public et/ou privé. C’est parce qu’il n’a rien, ni bien ni dette, que l’homme peut se révolter. C’est ce que l’on a pu voir en Tunisie ou en Égypte et plus tôt dans les pays dits de l’Est. Parce que lorsqu’il est endetté, l’homme ne peut ni se rebeller ni se soulever ni rejeter sa dette. On le voit bien aujourd’hui avec tous les cas de surendettement, la dette est la plus dangereuse de toutes les prisons. Il suffit de constater également le conditionnement de la majorité de la population américaine, qui vit exclusivement grâce à un endettement sans fin, pour mesurer combien cet étau paraît donc indestructible. Et il en va exactement de même pour les États et les dettes dites souveraines. Les exemples, au Sud de l’Europe, ne manquent pas. La Grèce en est l’ultime représentation. Un pays endetté perd toute souveraineté. Des citoyens endettés dans un pays lui-même endetté perdent toute forme de citoyenneté et de légitimité. Les décisions ne lui appartiennent plus et le peuple et le pays en question deviennent soumis aux institutions internationales.
Il n’est d’autre alternative, semble-t-il, aujourd’hui, que le remboursement de notre dette. Pour cause, notre dette, celle de la France, est, du point de vue des marchés financiers, en train de tutoyer la zone dangereuse. Fin 2013, l’endettement de la France se rapprochait dangereusement des 2 000 milliards d’euros. Il est ainsi en hausse de 84,3 milliards par rapport à 2012, où il avait déjà augmenté de 116,1 milliards. Et la France aurait pu s’en sortir plus mal, « les intérêts versés reculent de 9 % en 2013 en raison de la baisse des taux, mais aussi celle de l’inflation qui diminue la charge d’intérêt sur les titres indexés », indique l’Insee dans son communiqué. Chaque année, l’État Français rembourse péniblement 50 milliards d’euros d’intérêts. C’est la totalité de ce que rapporte l’impôt sur le revenu des Français. Cette somme est versée chaque année aux banques et aux créanciers de la France. À ce rythme, l’État n’aura pas fini de payer en 2030, en espérant qu’aucune crise ne vienne aggraver les dépenses ni augmenter les taux auxquels la France peut emprunter aujourd’hui. Ce qui est fort improbable ! En incluant le remboursement du capital, la dette est devenue le premier poste de dépense de l’État : 100 milliards d’euros au total sont engloutis chaque année au paiement de la dette. Une hémorragie permanente d’argent public vers un petit nombre de créanciers. Pendant ce temps, les villes, les régions, les administrations et de plus en plus de particuliers, sont dans un état proche sinon avéré de surendettement. Et il n’y aura bientôt plus d’argent…
Au fait, qui crée l’argent ? Qui crée la monnaie ? Poser cette question permet de répondre, en partie, à la problématique de la dette. Le traité de Lisbonne, passé en force en 2007 malgré le rejet du peuple français de ce traité par référendum – un comble pour l’Europe qui ne cesse d’affirmer haut et fort son attachement pour la démocratie ! – a consacré la Banque Centrale Européenne, indépendante du contrôle parlementaire, comme clef de voûte du système monétaire européen. Les gouvernements n’ont plus leur mot à dire en ce qui concerne la création de monnaie. Les politiques ont presque tous accepté cet état de fait et la « privatisation » d’un secteur aussi important que celui qui a pour mission de fabriquer de l’argent, ne choque plus personne. Grâce notamment au Traité de Lisbonne, mais aussi aux nombreux et précédents accords ou traités, les États européens empruntent exclusivement aux banques ou institutions privées à des taux variables selon leurs notations (à moins de 2 % pour la France à près de 8 % pour la Grèce) qui elles-mêmes empruntent à des taux proches de zéro à la Banque Centrale Européenne. N’importe quel être sensé se pose alors la question : mais pourquoi diable la Banque Centrale Européenne ne prête-t-elle pas directement aux différents États (à des taux forcément moins élevés) ? Car la principale préoccupation de la Banque Centrale Européenne n’est pas tant le développement harmonieux des peuples que la maîtrise absolue de l’inflation. C’est bien par crainte de l’inflation, l’ennemie absolue des plus riches et des possédants, que l’Europe est enfermée dans un système de fonctionnement et au final de pensée favorisant la maîtrise des dépenses.
En décidant, au milieu des années 70 dans la foulée du gouvernement américain (en 1971, le président R. Nixon décide, contre toute attente, de désindexer le dollar sur l’or), de privatiser la création de leur monnaie, les États Européens se sont engouffrés dans une incroyable spirale de la dette (en France, c’est V. Giscard d’Estaing, alors ministre des Finances dans le gouvernement Pompidou, qui prive à la Banque de France, banque nationalisée par le Front Populaire, le droit de battre la monnaie et de prêter directement à l’État français). À qui profite le crime ?