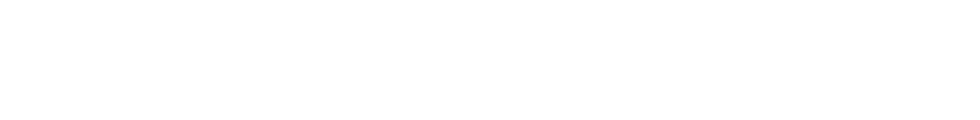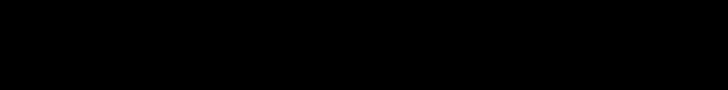Ce fut véritablement le film coup de poing du dernier festival de Cannes. Robin Campillo évoque avec nous le processus de création de ce film évènement qui retrace les tumultueuses aventures de l’association Act Up pendant les années Sida… Rencontre :
Pourquoi raconter l’histoire d’Act Up maintenant ?
Remontons un peu dans l’histoire. Les médias ont commencé à parler du Sida entre 1982 et 1983. A cette époque, je rentrais tout juste à l’Idhec, une école de cinéma à Paris, et je rencontre notamment Laurent Cantet. En fait, depuis le début de l’épidémie du Sida, je m’interroge sur plein de choses. J’ai tellement peur de cette épidémie, qui s’annonce, à l’époque, comme une véritable catastrophe. C’est très brutal et ça nous tombe dessus comme ça, quand je dis « nous », je veux parler de « nous les gays ». On savait que les hémophiles étaient aussi touchés, tout comme les toxicos. J’avais tellement peur de cette épidémie que je me suis réfugié un peu dans l’Idhec et donc dans le cinéma. Depuis toujours, j’ai eu envie de faire du cinéma. Et il se passe alors un truc assez étrange, je comprends que tous les cinéastes que je vénérais, tous ceux de la Nouvelle Vague, ne pouvaient évoquer un tel sujet qui était en train de se produire sous nos yeux. Le temps passe, je vis un peu dans une sorte d’inquiétude permanente, je finis mon école mais je ne peux pas faire de cinéma à l’époque. Plein de gens autour de moi sont touchés par la maladie, et j’ai une sorte de vision terrifiante de la vie. En 1992, je décide de m’engager au sein de l’association Act Up. J’étais très en colère de voir comment on (les institutions) traitait cette épidémie. Pendant tout ce temps, je pense à l’éventualité de faire un film sur le Sida, sans trop savoir comment m’y prendre. Cela me paraît même très abstrait. Pendant 4-5 ans, j’agis beaucoup au sein d’Act Up. Des années plus tard, après avoir fait « Les Revenants », j’ai écrit un scénario sur le Sida, qui s’appelle « Drug Holydays ». Curieusement, après plus d’un an d’écriture, je n’ai plus envie de le réaliser… Et ce n’est que très récemment où j’ai enfin compris ce que je voulais faire, non pas parler du début de l’épidémie, cette époque où l’on subissait le Sida, nous étions un peu des victimes, mais évoquer ce moment où on décide de prendre les choses en main. Le moment où on se réveille réellement. On décide de prendre un peu le pouvoir sur l’épidémie et de changer les choses. Je comprends aussi que c’est la notion de groupe qui m’intéresse, la manière dont cela se construit politiquement. La manière dont Act Up veut que l’on perçoive la maladie me paraît au final un bon matériel cinématographique. Il y est question de la parole et de la production d’images, mettre en image ces réunions où se décident les actions, mettre en image comment se construit ce collectif aussi, en réaction à la maladie. Je voulais également aborder la manière dont la maladie aussi pouvait vous « enlever » du présent et de vous définir uniquement en tant que malade.
Vous situez votre film pleinement dans l’action parfois violente…
Mon idée n’était ni de faire un film historique ni un film pédagogique. Je voulais un film qui retrace un moment de l’épidémie à partir des souvenirs que j’en avais, et parce que j’avais vécu cela au cœur de l’action justement. C’est avant tout une fiction. Le rapport avec ce qui se passe aujourd’hui, c’est au spectateur de le faire ensuite.
Aviez-vous l’intention de réveiller un peu les consciences face au Sida ?
Non. Ce n’était pas mon intention première. Je voulais raconter cette histoire de façon contemporaine. Ça, c’était mon intention. J’ai écrit le film à partir des souvenirs que j’avais de cette époque. Je n’ai pas eu une approche documentaire. J’aime bien l’idée d’un film fleuve, qui reste un peu flou et qui indique surtout un mouvement qui se construit autour de l’histoire des 3 personnages, de leur implication entre l’intime et le collectif qui naît. Je voulais parler de l’incertitude des liens intimes.
Le film est sous tension en permanence. Était-ce volontaire ?
Nous avons vécu des choses très intenses dans la réalité, alors forcément… On a vécu des choses très intenses presque de manière très ou trop normale. C’est ça que je voulais retranscrire aussi. Le Sida tuait des jeunes, nous trouvions cela très injuste, ce qui l’était d’ailleurs. Je m’aperçois cependant que cette jeunesse était aussi une chance pour nous. Cette vitalité nous permettait de rebondir très vite face à cette tragédie, et c’en était une. J’ai personnellement rhabillé le corps d’un ami avec sa mère, comme dans le film, je l’ai fait de manière presque détachée. Et ça, cela m’a toujours questionné. Je crois profondément qu’il s’agit d’un film très littéral plus que radical. Quand quelqu’un meurt, son corps reste. Longtemps parfois. Nous l’avons vécu tout ça… Un cinéaste un jour a dit « s’il y a trop de larmes à l’écran, il y en aura moins dans la salle ». Je le crois aussi. C’est pour cela que je n’ai pas non plus voulu quelque chose de trop larmoyant malgré la dureté du sujet et des images. Certaines scènes, notamment celles autour de la mort, je les ai vécus, et je les ai vécus comme dans une forme d’état second. C’est curieux à expliquer comme ça, mais c’est la sensation que j’en avais. Comme si nous étions un peu sous l’effet de drogue. Comme si nos cerveaux produisaient une chimie qui nous rendait notre quotidien supportable. Nous avons tourné le film dans l’ordre, cela permet aussi de comprendre comment ont réagi les acteurs. Notre dimension humaine nous rend parfois inhumain dans nos comportements.
Parfois on rit même…
Durant la projection à Cannes, il y a eu des rires dans la salle, oui. Cela permet d’évacuer la tension justement.
Est-ce un film militant ou politique ?
Certainement les deux, oui. Je montre dans le film le militantisme d’Act Up et puis il y a ma façon de faire de la politique en faisant ce film de cette façon. J’ai réellement essayé de montrer les choses telles que je les ai ressenties à l’époque. Il y avait beaucoup de théâtralité dans les comportements. Et ce n’est pas forcément péjoratif.
L’intensité dont on parlait est portée par la sincérité des comédiens…
On a travaillé sur la direction d’acteur, évidemment. Mais cette sincérité est essentiellement due à la qualité des comédiens. Je viens de comprendre d’ailleurs que je ne pourrais plus faire un autre film sans être totalement sûr de mon casting. Le choix des comédiens est primordial. Nous avons mis près d’un an à les trouver. J’ai été stupéfait, véritablement, par leur travail. C’est cruel, de faire un casting, on refuse plein de gens. Mais c’est un choix essentiel. Nous avons répété des scènes pour vérifier que le dialogue collait bien aux personnages. Nous avons tourné avec 3 caméras, c’était assez lourd comme dispositif. Et j’essaie toujours de filmer très rapidement, même si tout le monde n’est pas prêt, on y va. L’idée, un peu, c’est de perdre volontairement le contrôle. C’est tout un processus créatif. Il est aussi question de musicalité. Beaucoup.
Il est aussi question dans le film d’autres associations, comme Aides…
Je fais la part belle à Act Up, c’est vrai, je partage que suis un peu de mauvaise foi, notamment par rapport à Aides qui apparaît comme la bonne conscience et Act Up, la mauvaise… Je revendique ce parti pris, celui de le centrer autour d’Act Up essentiellement. Il faut savoir que lorsqu’on distribuait des capotes dans les lycées, c’est Aides qui nous les fournissaient. Ils nous filaient tous les trucs, il y avait une connivence entre les deux associations.
Vous n’êtes pas très tendre avec l’Agence Nationale pour la Recherche sur le Sida…
C’est vrai. Il était important pour moi de montrer comment les malades étaient devenus les premiers spécialistes de leur maladie et comment les chercheurs étaient abasourdis parfois par ces malades. À l’époque, le patron de l’ANRS était Jean-Paul Lévy, il a eu cette idée brillante d’intégrer Act Up dans ses démarches. Il s’est servi d’Act Up contre les labos de manière très intelligente.
La présentation du film à Cannes : quelles furent vos impressions ?
Je peux avoir, évidemment, un grand plaisir à recevoir un prix, mais l’idée de monter sur scène en public pour recevoir ce prix m’est complètement surréaliste. J’ai horreur de m’exposer. Donc, ne recevoir aucun prix ne m’aurait pas gêné. Je voulais surtout être à Cannes. Après on a tout de même reçu le Grand Prix et ce n’est pas rien ! Certains ne sont même pas sélectionnés. J’ai très mal vécu cette soirée à suspens. Je ne supporte pas cette attente. Je ne crache absolument pas dans la soupe, bien au contraire.
L’accueil du public ?
Je ne lis pas beaucoup la presse, à vrai dire, je suis quelqu’un de très angoissé de nature. Le public, visiblement, a très bien reçu le film. C’est génial.
Vous avez mis du temps à faire ce film… Était-ce une thérapie ?
J’ai beaucoup ressassé ces histoires. Je me suis préparé à faire ce film, mais pas d’un point de vue thérapique. Je peux passer à autre chose. Cela a été une forme de thérapie pour ma façon de faire du cinéma, peut-être pas forcément pour moi.
Le film évoque la fin de vie… Une idée pour un nouveau long-métrage ?
Il y a surtout la question de l’étrangeté de l’état spécifique juste avant la mort, j’avais déjà abordé ce sujet dans « Les Revenants ». J’ai envie de traiter ça comme une psychologie à part. Comme une perception du monde à part. J’ai envie de m’intéresser à ce sujet. À la sensorialité. Ma mère est morte durant l’écriture du scénario de « 120 battements à la minute ». Elle s’est retrouvée dans cet état précisément. Et on voit bien qu’on ne peut pas partager ces sensations, on dit souvent qu’il faut accompagner les morts, mais ça, cela ne se partage pas ! Cet état si étrange m’attire, j’ai envie d’aller voir des scientifiques à ce propos. Qu’en pensent-ils ? Que savent-ils ? Je ne sais pas là où ça va m’emmener. On verra bien.
On vous considère comme un fer de lance du cinéma engagé… Quel regard portez-vous sur le cinéma français ?
Pour qu’il y ait des films comme le mien, il faut bien qu’il y ait d’autres types de films, sans doute plus populaires… C’est comme ça que marche ! Après, je sens beaucoup d’empathie de la part des autres réalisateurs français vis-à-vis du film, c’est très sympa. Je ne pense pas pourtant être un fer de lance de quoi que ce soit. Mes films représentent une forme de liberté, sans doute. Après, on ne peut pas tout avoir. Souvent on dit qu’il y a trop de films français qui sortent. Tant mieux ! Nous avons la chance en France d’avoir une production encore préservée. Nous sommes pleins de réalisateurs à travailler le plus librement possible. En revanche, ce qui est certain, c’est que c’est compliqué d’exister dans l’espace du cinéma français, ça, c’est évident. En même temps, cette diversité est une énorme chance. La difficulté est de pouvoir prendre du temps pour écrire, pour faire un casting, pour réaliser, il faut laisser le temps au film de se faire dans nos esprits. Le film doit s’imposer par lui-même. J’ai la chance de réaliser, j’en suis pleinement conscient. Le cinéma se nourrit aussi d’autres choses que le cinéma, il est important de vivre, oui. Vivre.